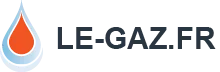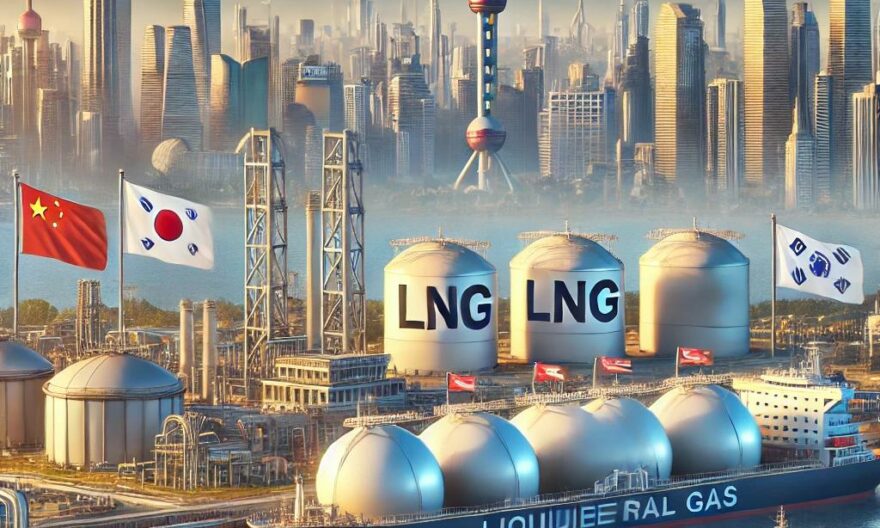
L’Asie, continent en pleine croissance économique, est devenue l’un des plus grands consommateurs de gaz au monde. Entre dépendance énergétique, enjeux géopolitiques et transition écologique, le gaz occupe une place centrale dans les politiques énergétiques asiatiques. Plongée dans une région où le gaz est à la fois une nécessité, un outil stratégique et un défi pour l’avenir.
Une consommation en forte hausse, portée par la croissance économique
Depuis les années 2000, la consommation de gaz naturel a explosé en Asie, tirée par le développement rapide de pays comme la Chine, l’Inde, ou encore les membres de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est). Cette demande s’explique notamment par une urbanisation galopante, une industrialisation massive, et un besoin croissant d’électricité pour accompagner le développement économique.
La Chine est aujourd’hui le plus grand importateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), devant le Japon et la Corée du Sud. Si le charbon reste dominant dans la production d’électricité, le gaz est perçu comme une alternative plus propre, permettant de réduire la pollution atmosphérique, très problématique dans les grandes métropoles asiatiques.
L’Inde suit une trajectoire similaire, avec une volonté affichée de réduire sa dépendance au charbon et d’intégrer davantage de gaz dans son mix énergétique. Les infrastructures se développent : terminaux méthaniers, gazoducs, capacités de stockage… Un effort massif est entrepris pour sécuriser l’approvisionnement.
Une dépendance forte aux importations
Malgré des ressources internes non négligeables, l’Asie demeure largement dépendante des importations pour répondre à sa demande en gaz. Le GNL représente une part importante de cette importation, du fait de l’éloignement des sources de production et de la géographie maritime de nombreux pays asiatiques.
Le Qatar, l’Australie et les États-Unis sont les principaux fournisseurs de GNL pour l’Asie. Cette dépendance énergétique pousse les pays asiatiques à signer des contrats à long terme, souvent indexés sur les prix du pétrole, afin de sécuriser leur approvisionnement. Ces accords créent des relations de dépendance mais aussi d’interdépendance, dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques croissantes.
Le cas du gazoduc Power of Siberia, reliant la Russie à la Chine, illustre bien cette dynamique. Après la dégradation des relations entre la Russie et l’Occident, Moscou s’est tourné vers l’Asie pour diversifier ses débouchés. Pékin, de son côté, y voit une manière de réduire sa vulnérabilité face aux routes maritimes potentiellement menacées.
Le gaz au cœur des rivalités géopolitiques
Le gaz est devenu un enjeu géopolitique majeur en Asie. La mer de Chine méridionale, par exemple, cristallise de nombreuses tensions entre la Chine, le Vietnam, les Philippines ou encore la Malaisie. Outre les enjeux territoriaux, cette zone recèlerait d’importantes réserves d’hydrocarbures, dont du gaz naturel, attisant les convoitises.
Autre foyer stratégique : l’Asie centrale. Des pays comme le Turkménistan ou le Kazakhstan disposent d’importantes réserves de gaz. La Chine y a investi massivement pour développer des gazoducs permettant d’acheminer cette ressource vers son territoire. Ces corridors énergétiques sont au cœur de l’initiative des Nouvelles Routes de la Soie, vecteur d’influence croissante de Pékin.
Enfin, le détroit de Malacca reste un point de passage crucial pour les importations asiatiques de GNL. Sa sécurité est un enjeu fondamental, notamment pour le Japon et la Corée du Sud, qui n’ont quasiment pas de ressources énergétiques domestiques.
Une transition énergétique encore incertaine
Si le gaz est perçu comme une énergie de transition vers des sources plus durables, son rôle à long terme est discuté. De nombreux pays asiatiques, notamment la Chine, ont annoncé des objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 ou 2060. Cela suppose, à terme, une réduction significative de l’usage des énergies fossiles, y compris le gaz.
Pour autant, le gaz continue d’être vu comme un « moindre mal » par rapport au charbon, en particulier dans les pays en développement. Il permet d’assurer une électricité relativement propre et stable, tout en soutenant la croissance économique.
Par ailleurs, des technologies comme le captage et le stockage du carbone (CCS) ou l’hydrogène « bleu » (produit à partir de gaz naturel avec captage du CO2) sont explorées pour prolonger l’usage du gaz tout en réduisant son impact environnemental.
Vers une Asie plus résiliente et diversifiée
Face à la volatilité des marchés énergétiques mondiaux, les pays asiatiques cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement, à développer des infrastructures communes et à renforcer leur coopération régionale. Des projets comme l’intégration énergétique au sein de l’ASEAN ou la mutualisation des stocks stratégiques sont à l’étude.
Le gaz continuera donc de jouer un rôle central en Asie dans les décennies à venir, mais son avenir dépendra largement de l’évolution technologique, des politiques climatiques, et des équilibres géopolitiques. La transition énergétique est en marche, mais elle devra composer avec les réalités économiques et stratégiques d’un continent aussi vaste que contrasté.